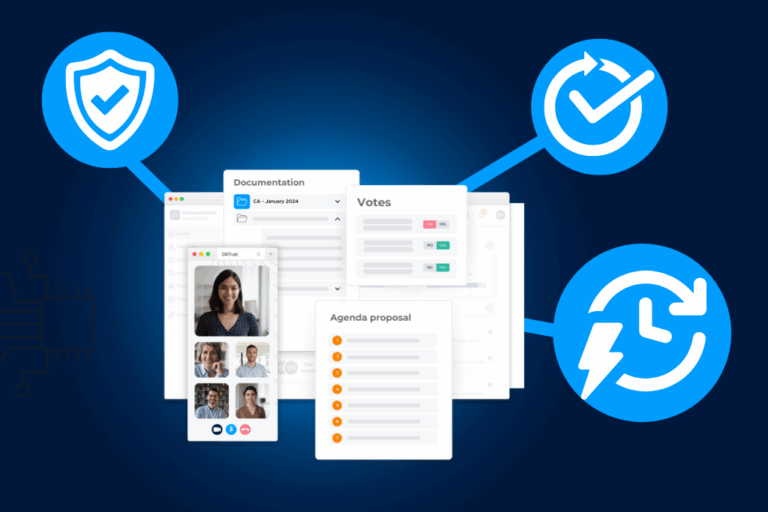L’incertitude réglementaire est devenue la norme. Alors que la conformité suivait autrefois des cycles plus prévisibles, les nouvelles règles et obligations apparaissent aujourd’hui de manière beaucoup plus fréquente. Parfois sans préavis et avec des conséquences importantes sur les pratiques de l’entreprise.
Imaginez : après plusieurs mois de préparation, les politiques internes sont mises à jour, les équipes sont formées, tout est conforme aux dernières exigences. Jusqu’à ce qu’une nouvelle directive impose de nouveaux ajustements. Dans ce contexte mouvant, les directions juridiques doivent en permanence coordonner avec les autres services. Elles s’adaptent rapidement et communiquent clairement.
De la transparence ESG à la régulation de l’intelligence artificielle, les cadres réglementaires évoluent dans presque tous les domaines. Cet article revient sur les développements récents et propose des pistes concrètes pour aider les équipes juridiques. Elles doivent anticiper les évolutions, gérer les risques, et accompagner l’organisation dans un environnement en perpétuel changement.
Exemples récents d’évolutions réglementaires impactant les professionnels du droit
1. Réglementations ESG : un cadre en pleine évolution
Les exigences en matière de reporting Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) évoluent à une vitesse vertigineuse. Par exemple, dans l’Union européenne, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) est entrée en vigueur en 2025. Elle oblige les grandes entreprises (plus de 1000 salariés) à publier des données de durabilité.
À première vue, les petites entreprises pourraient penser qu’elles ne sont pas concernées. Pourtant, elles peuvent en ressentir les effets indirectement. En particulier si elles fournissent des grands groupes soumis à ces obligations. Illustration : la maison de mode Hugo Boss demande à ses fournisseurs de se conformer aux normes de reporting en matière de durabilité. Même s’ils n’y sont pas légalement tenus, cela est important. Ainsi, un petit fabricant de tissus qui souhaite conserver un contrat avec une grande marque peut être amené à communiquer ses données sur les émissions et les conditions de travail.
En parallèle, la directive européenne sur les lanceurs d’alerte impose, depuis peu, la mise en place de canaux de signalement internes sécurisés pour les entreprises de 50 salariés ou plus. Bien qu’elle ne fasse pas techniquement partie de la réglementation ESG, elle renforce la transparence et l’éthique au sein des entreprises. Chaque pays membre interprète et applique cette directive différemment. D’où l’importance de prévoir une conformité localisée et une communication claire avec les collaborateurs.
2. AI Regulations: A Work in Progress
L’intelligence artificielle (IA) fait désormais partie de notre quotidien, des assistants vocaux aux algorithmes complexes utilisés en entreprise. Mais à mesure que l’IA se développe, son encadrement réglementaire progresse aussi — et les juristes doivent rester en veille constante.
Secteur financier : la réglementation DORA (Digital Operational Resilience Act) impose aux institutions financières de garantir que leurs outils de lutte contre la fraude ou d’analyse de risque basés sur l’IA soient sécurisés, justes et résilients. Certaines banques mettent déjà en place des comités de supervision de l’IA pour veiller à leur conformité.
Secteur de la santé : les dispositifs médicaux assistés par l’IA doivent répondre aux exigences du Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) et au RGPD. Ces outils doivent respecter des standards stricts en matière de sécurité et d’efficacité.
Industries créatives : la directive européenne sur le droit d’auteur précise que les droits reviennent en principe au créateur ou au propriétaire de la technologie. Toutefois, en l’état, elle ne traite pas clairement des créations générées par l’IA. Cela crée ainsi une zone d’incertitude juridique. Les premiers litiges montrent que la jurisprudence commence à se construire sur le rôle de l’IA dans la propriété intellectuelle.
Enfin, la future réglementation européenne sur l’IA (AI Act), attendue pour 2025, prévoit une classification des systèmes d’IA par niveaux de risque. Les secteurs sensibles comme la finance et la santé seront soumis aux normes les plus strictes. Les professionnels du droit devront accompagner les entreprises pour garantir la conformité. Ils réaliseront des évaluations de risque, des mécanismes de transparence et de redevabilité. Ils devront aussi conseiller sur les implications juridiques de l’IA, en veillant à des usages éthiques, en particulier dans les domaines à haut risque.
Incertitude réglementaire : quels défis pour les directions juridiques ?
Les directions juridiques évoluent aujourd’hui dans un environnement complexe, où les réglementations changent rapidement et varient selon les juridictions. Conformité et innovation exigent à la fois une expertise technique, une collaboration interfonctionnelle étroite et une vision d’ensemble.
Voici trois défis majeurs auxquels sont confrontées la plupart des organisations :
1. Anticiper les évolutions réglementaires
Pour rester en conformité, les départements juridiques doivent surveiller activement l’évolution des lois et règlements, souvent dans plusieurs domaines et zones géographiques à la fois.
Cela nécessite des systèmes et des processus de veille juridique leur permettant d’identifier les changements pertinents à un stade précoce. Ils doivent aussi en évaluer les impacts potentiels dans un contexte incertain.
? Exemple : Une entreprise technologique présente aux États-Unis et dans l’UE a mis en place une équipe dédiée à l’intelligence réglementaire. Cette équipe suit les évolutions législatives à venir. Par exemple, les règles de transfert de données ou les propositions de régulation de l’IA. Elle fournit aussi des rapports réguliers aux équipes produits et juridiques pour anticiper les adaptations nécessaires.
2. Gérer la conformité à l’échelle internationale
Les entreprises multinationales doivent se conformer à des réglementations parfois très différentes selon les régions. Dès lors, mettre en place une stratégie de conformité unique et globale devient de plus en plus complexe.
Une méthode efficace consiste à s’aligner sur le standard le plus exigeant applicable. Cela permet de garantir la conformité dans toutes les zones, sans adaptation permanente.
? Exemple : Un groupe de distribution présent dans plusieurs pays de l’Union européenne a adopté un système d’étiquetage produit harmonisé basé sur la norme la plus stricte disponible localement. Ce choix garantit une présentation uniforme des produits. En outre, il réduit le risque de non-conformité transfrontalière.
3. Trouver l’équilibre entre innovation et risque juridique
Alors que les entreprises adoptent des technologies innovantes (IA, blockchain, analyse de données avancée…), il est essentiel de ne pas laisser la régulation en retard par rapport à l’innovation. Les directions juridiques doivent collaborer étroitement avec les équipes conformité, IT et gestion des risques. Elles évaluent ainsi les enjeux juridiques en amont de tout déploiement.
? Exemple : Une entreprise de services financiers souhaitant utiliser l’IA générative pour son service client a mis en place un comité interfonctionnel. Il regroupe des experts en protection des données, juristes et spécialistes IT. Ce comité a mené une évaluation des risques. Il a vérifié la conformité au futur AI Act européen, et rédigé des lignes directrices internes encadrant l’usage de l’IA.
5 conseils pour faire face à l’incertitude réglementaire
L’incertitude réglementaire ne permet pas toujours de s’appuyer sur des cycles de planification longs. Pour rester réactives et conformes, les directions juridiques doivent mettre en place des systèmes flexibles. Elles doivent aussi exploiter la technologie de manière stratégique et favoriser une coordination étroite entre services.
Voici cinq bonnes pratiques éprouvées pour aider les organisations à suivre le rythme des évolutions réglementaires :
1. Construire des cadres de conformité flexibles
Les cadres de conformité trop rigides peuvent devenir rapidement obsolètes, surtout dans un contexte de réglementation mouvante. C’est pourquoi il est préférable d’adopter une approche modulaire. Cette approche permet de mettre à jour certaines composantes sans devoir repenser tout le système.
? Exemple : Une entreprise internationale de logistique a mis en place un cadre de conformité reposant sur un socle commun de principes. Cela a été complété par des modules adaptables selon les régions. Cela lui permet de rester conforme aux réglementations locales, tout en maintenant des standards internes homogènes malgré l’incertitude réglementaire.
2. S’appuyer sur la technologie pour surveiller la conformité et les risques
Les équipes juridiques peuvent tirer parti d’outils digitaux pour suivre les évolutions réglementaires et réduire les risques plus efficacement. Lorsqu’ils sont correctement sécurisés, les systèmes basés sur l’IA permettent de réduire considérablement la charge administrative. Ils obtiennent aussi des analyses en temps réel. Face à l’incertitude réglementaire, la technologie devient un levier décisif pour surveiller et faciliter la conformité.
? Exemple : Un cabinet d’avocats a déployé un outil d’analyse contractuelle alimentée par l’IA.
L’outil détecte les écarts par rapport à la politique de l’entreprise et suit les exigences spécifiques à chaque juridiction. Conforme aux réglementations en matière de protection des données, il fonctionne dans un environnement interne sécurisé.
3. Renforcer la collaboration interfonctionnelle
La conformité réglementaire implique souvent plusieurs domaines — IT, opérations, gestion des risques… Mettre en place une collaboration structurée entre les départements permet d’intégrer les enjeux juridiques dès les premières étapes des projets.
? Exemple : Une banque européenne a constitué une task force interfonctionnelle réunissant les équipes juridiques, cybersécurité et opérations. Ils se préparent à l’entrée en vigueur de DORA. Ce travail conjoint a permis une mise en conformité plus rapide et une répartition claire des responsabilités.
4. Investir dans la simulation de scénarios et la formation ciblée
Des formations régulières et des exercices de simulation permettent aux équipes de se préparer aux évolutions réglementaires. Ils peuvent anticiper les adaptations nécessaires. Cela renforce les processus internes et évite les ajustements de dernière minute. Il s’agit d’un écueil courant chez les entreprises multinationales confrontées à des règles locales diverses.
? Exemple : Un fabricant étranger organise des ateliers de simulation de conformité.
Ces sessions permettent aux équipes de tester leur niveau de préparation et de coordonner leurs plans d’action avant l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations.
5. Suivre les précédents juridiques et les interprétations réglementaires
Les décisions de justice et les recommandations des autorités peuvent offrir des indications sur la manière dont certaines règles pourraient être appliquées à l’avenir. En assurant une veille juridique active, les directions juridiques peuvent adapter leurs plans de conformité en conséquence. Ainsi, elles peuvent réduire l’incertitude réglementaire.
? Exemple : En suivant de près l’affaire Getty Images vs Stability AI, les juristes anticipent les premières orientations jurisprudentielles. Cela concerne l’application du droit d’auteur aux contenus générés par l’IA, tant dans l’UE qu’à l’échelle internationale.
Anticiper grâce à la bonne stratégie et aux bons outils
L’incertitude réglementaire est une réalité durable à laquelle aucune organisation ne peut échapper. Heureusement, les directions juridiques qui adoptent une stratégie de conformité proactive peuvent transformer ces contraintes en avantage concurrentiel.
Pour cela, des cadres de conformité adaptables, l’usage stratégique des technologies et une collaboration interservices solide sont des leviers clés. Cela permet de garder une longueur d’avance face à l’évolution des réglementations.
Des domaines comme la réglementation ESG, la gouvernance de l’IA ou encore le droit du commerce international vont continuer à évoluer. Cela exige des juristes qu’ils soient réactifs, agiles et bien informés.
Les organisations qui investissent dans l’intelligence réglementaire, la planification par scénarios et la formation des collaborateurs seront mieux armées pour faire face aux risques tout en préservant leur efficacité opérationnelle.