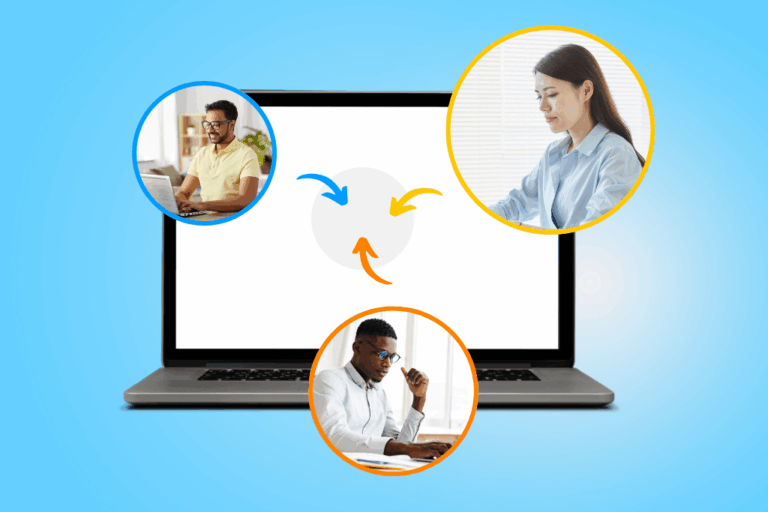Avec la montée en puissance des outils de technologie juridique (LegalTech) ces dernières années, de nombreuses équipes se sont heurtées à un défi de taille : la résistance au changement. C’est pourquoi la gestion du changement est devenue une composante incontournable de toute démarche d’adoption de nouveaux outils. Cela est particulièrement vrai dans les métiers historiquement plus réticents, comme les professions juridiques.
Lorsqu’il s’agit du rôle de secrétaire général, par exemple, des facteurs psychologiques et émotionnels bien identifiables entrent en jeu face au changement. Une peur de perdre l’essence même de son métier peut émerger, rendant la résistance plus profonde qu’une simple réticence. Les interrogations liées à l’identité professionnelle sont vives. Celles concernant le sens du rôle et sa pertinence le sont également dans un paysage d’entreprise en pleine transformation.
Les ressorts psychologiques et émotionnels de la résistance au changement
L’adoption de nouvelles technologies a également un impact psychologique profond, notamment sur la perception de sa propre valeur professionnelle. L’essor des outils de gouvernance assistés par l’IA peut engendrer une véritable crise identitaire. Les secrétaires généraux peuvent ainsi douter de leur rôle dans un environnement où des algorithmes sont capables de générer des rapports, planifier des réunions ou encore formuler des recommandations en matière de conformité.
La peur d’être remplacé par une machine ne se limite pas à la crainte de perdre son emploi : elle touche aussi à la reconnaissance, au respect, et à l’importance perçue de la contribution humaine dans les instances de gouvernance. Ce type d’inquiétude dépasse largement le cadre du secrétariat général et peut concerner de nombreux professionnels du droit et de la gouvernance.
La remise en question des pratiques établies
L’une des raisons principales de la résistance au changement réside dans le confort des pratiques établies. Des routines bien ancrées offrent un sentiment de sécurité, et les bouleverser peut entraîner de l’inconfort, voire de l’anxiété. Depuis des années, les secrétaires généraux pilotent avec rigueur les processus de gouvernance, les structures juridiques et les réunions stratégiques. Or, les outils LegalTech même les plus avancés viennent bouleverser cet équilibre. Pourquoi ? Parce que des mécanismes comme l’automatisation, bien qu’efficaces, rompent avec les méthodes de travail traditionnelles, si familières.
Le phénomène de dissonance cognitive
À cette première difficulté s’ajoute un effet bien connu : la dissonance cognitive. Beaucoup de secrétaires généraux reconnaissent les bénéfices de la transformation numérique. Parmi ces bénéfices, on compte le gain d’efficacité, la réduction des erreurs, et la conformité renforcée. Pourtant, ils ressentent également un tiraillement intérieur. Autrement dit, ils peinent à concilier ces avantages objectifs avec leurs craintes plus personnelles : perte de sécurité, remise en question de leur rôle, diminution de leur influence. Résultat : une forme de résistance non pas par rejet de la technologie, mais par peur de ce qu’elle implique à long terme pour leur position.
Une autorité perçue comme menacée
Autre facteur majeur : la crainte de perdre une part de leur autorité. Les secrétaires généraux sont souvent perçus, à juste titre, comme des gardiens : gardiens de l’information, des priorités, des communications stratégiques. Ils veillent à ce que les dirigeants reçoivent les informations les plus pertinentes au bon moment. L’automatisation vient bousculer cette posture en donnant un accès direct à l’information, parfois sans médiation. Cette évolution peut être vécue comme une perte de contrôle, et donc comme une atteinte à leur légitimité. Pourtant, en réalité, cette autorité demeure, puisqu’ils restent les garants de l’outil de gouvernance, et de son bon usage.
L’appréhension technologique
Enfin, une barrière plus émotionnelle : l’inquiétude liée à la maîtrise des outils numériques. Nombre de professionnels du droit ont consacré leur carrière à la gouvernance et à la conformité, et non nécessairement à la technologie. Face à l’accélération de la transformation numérique, certains peuvent se sentir dépassés. Le manque de confiance dans leurs compétences numériques peut accentuer leur résistance, nourrissant un cercle vicieux. En effet, moins ils osent s’engager, plus l’écart se creuse.
Ces différents éléments ne constituent qu’un aperçu des ressorts profonds de la résistance au changement. Bien qu’ils puissent concerner l’ensemble des métiers du droit, ils prennent une dimension particulière chez les secrétaires généraux. Mais alors, quelles sont leurs préoccupations spécifiques ? Explorons-les dans la suite.
Préoccupations spécifiques des secrétaires généraux face au changement
1. Vais-je perdre en importance et en légitimité ?
Au-delà des enjeux évoqués précédemment, les secrétaires généraux nourrissent une crainte particulière. Ils se voient peu à peu éloignés de ce qui constitue le cœur même de leur rôle. Leur fonction repose sur la discrétion, la connaissance fine des rouages institutionnels et la qualité des relations humaines. À mesure que certaines tâches sont automatisées, ils redoutent que ces dimensions clés soient reléguées au second plan.
Or, aucune LegalTech ne peut remplacer la confiance et la posture de conseil que les secrétaires généraux construisent au fil des années.
Les membres du conseil comptent sur eux non seulement pour leur expertise procédurale, mais aussi pour leur capacité à lire entre les lignes, à gérer des personnalités complexes et à faciliter les échanges. L’automatisation peut renforcer les processus, mais elle ne remplace pas l’intelligence relationnelle, si essentielle à un leadership efficace.
2. Vais-je perdre en influence dans les prises de décision ?
Historiquement, les secrétaires généraux occupent une place stratégique au sein des instances dirigeantes. Cette position se doit à leurs relations de confiance et à leur fine compréhension des attentes du conseil. Leur capacité à naviguer avec discrétion dans les arcanes hiérarchiques est un atout majeur. Pourtant, l’arrivée des LegalTech semble remettre en question cet équilibre. Si la technologie permet d’optimiser la gouvernance, le « facteur humain » reste-t-il indispensable ? La véritable menace pour leur influence, c’est l’invisibilité.
Leur efficacité réside dans leur proximité avec les dirigeants : une proximité à la fois concrète et symbolique. À l’heure des tableaux de bord numériques et des réunions dématérialisées, il est légitime de craindre que les conversations informelles disparaissent.
Pourquoi cela n’arrivera pas.
La vérité, c’est que les secrétaires généraux conserveront leur influence, à condition de se positionner comme experts de la gouvernance numérique. Ils sont souvent à l’initiative des transformations technologiques et en pilotent les outils, comme les plateformes de gestion des conseils.
La technologie ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un levier. L’enjeu est d’instaurer un modèle hybride où le secrétariat général et l’outil coexistent. Une plateforme de gouvernance, si puissante soit-elle, n’a de valeur que si elle est guidée par un professionnel aguerri. Ce professionnel doit être capable d’en extraire des décisions éclairées.
Bien accompagnée, cette évolution permet aux secrétaires généraux de ne plus être perçus comme de simples garants administratifs, mais comme des facilitateurs stratégiques, à l’interface entre technologie et gouvernance.
Prêt·e à impulser le changement ?
Les secrétaires généraux tournés vers l’avenir amorcent déjà cette transition. L’enjeu n’est plus de subir la technologie, mais de mener la réflexion sur la manière dont elle doit être intégrée.
Les secrétaires généraux qui réussiront demain sont ceux qui sauront faire évoluer les perceptions. Ils démontreront aux membres du conseil et aux dirigeants que les outils LegalTech, aussi puissants soient-ils, sont efficaces. Et cela n’est vrai que s’ils sont guidés par une intelligence humaine. Car au fond, tout part de l’humain : sans vision, interprétation, et accompagnement, un outil ne peut rien faire seul.