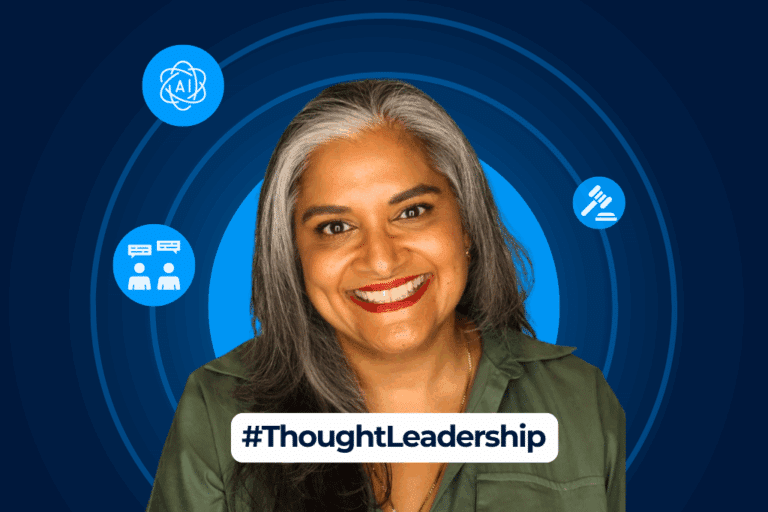Les directions juridiques internes et les tâches administratives mènent toujours un combat sans fin. Les professionnels du droit ont traversé de nombreuses vagues de changement : réduction des budgets, arrivée de nouvelles technologies juridiques censées révolutionner leur quotidien… Mais, concrètement, qu’est-ce qui a vraiment changé ? D’après notre enquête menée au 4e trimestre 2024 en partenariat avec Above the Law, la réponse est claire : pas grand-chose. Du moins sur les aspects essentiels.
Malgré l’intégration de nouveaux outils et l’apparition de nouveaux rôles, de nombreuses équipes juridiques restent accaparées par des tâches répétitives. Le travail administratif continue de grignoter un temps précieux. C’est un temps qui pourrait être consacré à la stratégie, au conseil aux métiers ou à des sujets juridiques à forte valeur ajoutée.
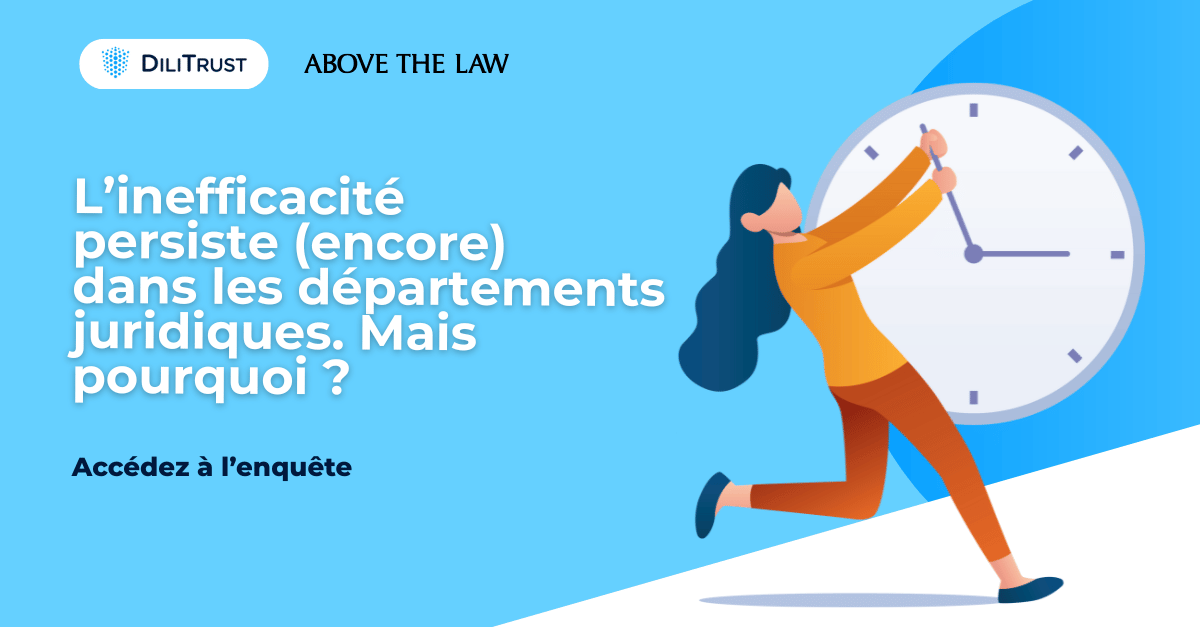
Le quotidien d’un professionnel du droit : ce que disent les chiffres
Les juristes portent de nombreuses casquettes… mais la réalité de leur emploi du temps en dit long. Notre enquête révèle à quel point leur journée est accaparée par des tâches routinières, souvent éloignées du droit.
Les principaux enseignements :
- 6 % des répondants déclarent que leur journée est presque entièrement consacrée à de l’administratif.
- 28 % se disent submergés par ces tâches.
- 55 % s’en sentent partiellement accaparés.
- Seuls 12 % consacrent la majeure partie de leur temps à des missions juridiques à forte valeur ajoutée.
Autrement dit, près de 9 juristes sur 10 ne se consacrent pas principalement à ce qui fait leur cœur de métier. Ce décalage entre les compétences juridiques et leur utilisation réelle engendre de nombreuses difficultés internes. Cela affecte tant en matière de motivation que d’efficacité.
Les tâches répétitives et les processus manuels freinent les équipes juridiques
Lorsqu’on parle de la charge administrative des équipes juridiques, il s’agit souvent de tâches redondantes, chronophages et à faible valeur ajoutée. Pour mieux comprendre pourquoi l’administratif reste un défi majeur, revenons sur les principaux enseignements de l’enquête.
Les tâches les plus chronophages
L’enquête s’est également penchée sur les tâches qui consomment le plus de temps. Plusieurs points de friction bien connus se dégagent — et certains vous sembleront sûrement familiers…
- Gérer les e-mails internes et les questions juridiques courantes
31 % des répondants déclarent passer au moins 8 heures par semaine à traiter des questions par e-mail. Résultat : frustration au sein des équipes, souvent happées dans des échanges à faible valeur ajoutée sur des sujets qui ont parfois déjà été traités. - Traiter les demandes internes de contrats
32 % des répondants consacrent plus de huit heures par semaine à la gestion contractuelle. Parmi les contrats internes, les accords liés aux ventes sont les plus fréquents. Le principal obstacle ? Les demandes arrivent souvent sans contexte suffisant, générant de nombreux allers-retours, ralentissant les opérations et éloignant les équipes de leurs missions stratégiques. - Rechercher des documents numériques
34 % des répondants affirment passer entre 2 et 4 heures par semaine à rechercher des documents. Le temps passé à retrouver une information pourtant simple révèle un problème d’accessibilité des fichiers. Cela alimente la frustration des équipes juridiques et alourdit encore leur charge de travail.
Les juristes doivent sans cesse passer d’une tâche urgente et ponctuelle à une réflexion stratégique plus large. Mais sans une structure adaptée, il devient difficile de rester concentré. À terme, cette pression continue finit par peser lourd. Lorsque les professionnels du droit passent l’essentiel de leur temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, il n’est pas étonnant qu’ils se sentent frustrés. Ils peuvent même se sentir déconnectés de l’impact qu’ils pourraient avoir.
Les vraies conséquences de la surcharge administrative
Traditionnellement perçus comme des gestionnaires des risques et des conseillers stratégiques, les professionnels du droit se retrouvent aujourd’hui bien souvent accaparés par des tâches opérationnelles du quotidien. Et ce décalage ne se limite pas à leur satisfaction personnelle. En effet, il a un impact réel sur l’ensemble de l’organisation.
Prenons l’exemple d’une entreprise technologique de taille moyenne où les équipes juridiques passent plusieurs heures chaque semaine à mettre à jour manuellement des tableaux de suivi de contrats. Elles répondent aussi aux sollicitations répétées de l’équipe Sales ou encore relisent des échanges d’e-mails pour retrouver des informations contextuelles. Dans un cas précis, un juriste a ainsi passé près de deux jours complets à finaliser l’approbation d’un simple contrat fournisseur. C’est un temps précieux qui aurait pu être consacré à accompagner l’entreprise sur un changement réglementaire majeur.
Des tâches chronophages qui freinent la valeur stratégique
Et ce n’est pas un cas isolé. Dans tous les secteurs, les directions juridiques passent bien plus de temps qu’elles ne le souhaiteraient sur des tâches qui ne nécessitent pas réellement d’expertise juridique. Mise en forme de documents, recherches d’anciennes versions de contrats, relances interminables pour obtenir une validation… Ces missions drainent l’énergie des équipes et repoussent au second plan les travaux stratégiques.
En conséquence, les départements juridiques risquent de se déconnecter des décisions stratégiques prises rapidement. Le moral des équipes chute lorsque les talents sont sous-exploités. Et à terme, l’entreprise peut finir par percevoir sa direction juridique non plus comme un partenaire stratégique. Au contraire, elle peut être vue comme un simple service support réactif.
Impact sur les équipes juridiques
L’enquête menée auprès des professionnels du droit s’est penchée sur les tâches les plus frustrantes du quotidien et sur leur impact opérationnel. Chez DiliTrust, nous avons constaté qu’au-delà de l’inefficacité ressentie, ces tâches répétitives affectent le moral des équipes. Cela nuit aussi à la perception globale de la fonction juridique dans l’entreprise.
Voici les principaux enseignements :
- La frustration monte lorsque des collaborateurs hautement qualifiés passent leurs journées sur des tâches qui pourraient facilement être automatisées. Cela entraîne un désengagement progressif et une perte de motivation à innover.
- Le manque de clarté sur les priorités désaligne les équipes. Il ralentit aussi la collaboration entre les départements, augmentant les inefficacités internes.
- Les contributions stratégiques sont ignorées ou retardées, affaiblissant la voix du juridique dans les prises de décisions clés. Cela expose l’entreprise à des risques accrus si des choix sont faits sans validation juridique.
- La direction juridique est perçue comme un frein, et non comme un facilitateur business. Cette perception nuit à la confiance entre équipes et limite les consultations en amont des projets.
Selon les réponses ouvertes du sondage, 21 % des professionnels citent le travail administratif comme le point le plus frustrant de leur poste. Et lorsqu’on leur demande ce sur quoi ils aimeraient se concentrer, la recherche juridique (27 %) et le conseil stratégique (23 %) arrivent en tête. C’est une preuve claire d’un besoin de se recentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Conseils pour dégager du temps et se recentrer sur les missions à forte valeur ajoutée
La technologie n’est pas une baguette magique — elle ne résout pas tous les problèmes à elle seule. Cela dit, elle constitue une base solide pour faire évoluer les équipes juridiques vers un environnement de travail plus efficace et plus satisfaisant.
Des gains de temps concrets avec l’automatisation
| Tâche | Temps manuel | Avec un CLM & l’IA |
| Recherche de clauses | 1 à 3 heures | 1 minute |
| Vérification des dates d’échéance | 1 à 3 heures | 5 minutes |
| Validation des versions de contrat | Jusqu’à 1 journée | 6 minutes |
| Lecture de contrats complexes | 2 à 3 jours | 10 minutes |
| De la création à la signature | Plusieurs semaines | Quelques jours |
En récupérant ne serait-ce qu’une partie de ces heures perdues, les équipes juridiques peuvent réinvestir leur énergie là où elle est réellement utile. Mais pour cela, la mise en place d’une solution ne peut se limiter à un simple déploiement logiciel.
Le facteur humain au cœur de la transformation
Le facteur humain doit rester central — notamment dans une démarche de conduite du changement. Car au fond, toute transformation commence par les personnes. Cela implique de prendre le temps d’identifier les sources d’inefficacité. Il est important d’écouter les frustrations du quotidien et de construire une adhésion interne au changement. Avant même cela, les responsables juridiques doivent impliquer leurs équipes dans la définition d’un fonctionnement « amélioré ». Ils doivent tracer, avec elles, le chemin à suivre.
Et pourtant, malgré la présence d’outils de gestion documentaire ou de workflows, de nombreux départements juridiques continuent de travailler en silo. Les processus restent invisibles et les outils ne communiquent pas entre eux. De plus, le suivi est souvent manuel. Mais le problème ne réside pas uniquement dans la technologie. Les équipes n’ont pas toujours de processus clairs, de priorités partagées, ni de liens solides avec les autres départements. Ce manque de structure engendre confusion et surcharge mentale.
Autant de raisons qui soulignent l’importance d’analyser son environnement, et de bien réfléchir aux conditions du changement.
Facteurs clés à prendre en compte pour accompagner le changement
Tout changement doit s’appuyer sur une stratégie de communication claire et adaptée. Chaque partie prenante a des attentes différentes : certains seront sensibles à l’efficacité opérationnelle, d’autres à la réduction des risques. D’autres encore seront sensibles au retour sur investissement. Mettre en lumière ces bénéfices — de manière ciblée — permet de valoriser concrètement la transformation. Pour ancrer le changement dans la durée et renforcer l’alignement des équipes. Envisager plusieurs leviers peut être bénéfique :
- Mettre en place des plateformes de reporting centralisées (au lieu d’échanger par e-mails) pour plus de transparence, de visibilité et de fluidité dans les échanges.
- Introduire un système de priorité clair (type feu tricolore) pour indiquer ce qui est urgent, ce qui peut attendre, et ce qui est en cours.
- Proposer des formations régulières pour développer un bon sens juridique opérationnel : savoir ce qui est critique, quand il faut escalader une situation, et quand une action peut être prise en autonomie.
Donner aux collaborateurs des cadres de décision clairs pour limiter le recours excessif aux validations internes. L’objectif n’est pas seulement d’automatiser, mais d’autonomiser. Car même les meilleurs outils technologiques échoueront si les équipes ne savent pas comment les utiliser, ou pire, si elles n’y croient pas. Reprendre le contrôle du temps et mieux structurer les processus ne revient pas seulement à « gagner des heures ». C’est redonner du sens au travail juridique et révéler tout le potentiel stratégique des équipes en interne.
Préparer l’avenir du travail juridique
Les juristes ne réclament pas moins de responsabilités — ils souhaitent se concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsqu’ils sont noyés sous les e-mails, les fichiers à suivre ou les relances de validation, la vision d’ensemble se perd.
Mais ce modèle n’est pas une fatalité. Avec les bons outils, des processus mieux définis et un alignement renforcé entre les équipes, les directions juridiques peuvent reprendre la main sur leur temps… et sur leur rôle. Il ne s’agit pas seulement de travailler plus vite, mais de travailler mieux — avec plus de clarté, plus d’impact et plus de sens.